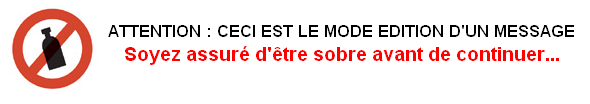Page 1 sur 2
Posté : jeu. juil. 03, 2008 8:11 am
par thierry de binch
bonjour , la différence entre le monde rural du XIXème siècle et le monde rural du MA est t'elle grande à votre avis , en faisant abstraction de l'obligation scolaire bien sur
Posté : jeu. juil. 03, 2008 12:41 pm
par le furet
oui
Posté : jeu. juil. 03, 2008 3:21 pm
par yrwanel
Posté : ven. juil. 04, 2008 4:39 am
par thierry de binch
ok autant pour moi
Posté : dim. juil. 06, 2008 11:45 am
par thillo
Ah bah, à question simple, réponse simple

Posté : dim. juil. 06, 2008 12:33 pm
par le furet
Blague à part, c'est une question posée à l'agreg' ça. Demande à Hengist.
A+
Posté : ven. juil. 11, 2008 1:47 pm
par thierry de binch
boire l'eau du puit , s'éclairer à la bougie ,une seule pièce commune pour vivre ,faire touts les travaux des champs à la main ,faire ses vétements soi même etc etc la liste est longue ...quel confort le paysan du XIXème a t'il de plus que le paysan mediéval dans son quotidien.....
Posté : dim. juil. 13, 2008 6:11 pm
par yrwanel
Que le travail à force d'homme, en fonction des saisons, à force animale surtout: on bosse pas la nuit...
Merveille du tracteur: y a des spots => le fermier turbine aussi la nuit...
Produits chimiques épandus: pas top pour la santé...Le cancer du poumon atteint très souvent le paysan non-fumeur! (d'autres bricoles aussi)
Plus de travaux en commun qui faisaient un réseau social.
L'est seul sur son champ.
Le suicide est aussi une cause de mortalité non négligeable...
Y avait pas ces p... de normes, donc pas ta récolte d'une année écrabouillée sous ton nez pour cause de quota (pas top pour le moral non plus ça)
Avant: pas de produits pesticides et autres... moins de nappe phréatiques polluées et devenues impropres à la consommation.
Le paysan a la TV.
Posté : lun. juil. 14, 2008 3:32 am
par hellin
Coprolithe, pardon mais... le tracteur, l'épandage, les pesticides, les normes, les quotas, la TV... c'est pas plutôt tout au long du XXème ? même parfois fin XXème...
Posté : lun. juil. 14, 2008 5:19 am
par yrwanel
Niveau "grandes exploitations" la mécanisation a démarré assez tôt.
=> besoin de moins de main d'oeuvre et exode rural allant alimenter l'industrialisation plein fin XIXème.
Le train a aussi "aider" à modifier des orientations agricoles: transport plus rapide permettant des "spécialisations" de certaines régions au détriment de la polyculture antérieure.
Le tout avec des courants de pensée "productivité, rendement, etc..." appliqué à l'agriculture aussi.
14-18 a accéléré le processus: pas mal d'hommes morts ou revenant handicapés + mécanisation plus poussée.
Bon: TOUT n'a pas évolué à la même "vitesse". Cela a aussi dépendu de la configuration des sols et ce qu'on y cultive.
Ce qui fait que effectivement, mi-XXème, il y a encore des "poches" fonctionnant "à l'ancienne".
Tout dépend aussi quelles modifications on envisage....
Si c'est l'eau au robinet, l'électricité, le chauffage central, le tout à l'égout...c'est encore autre chose!
Y a encore des petits villages où le "tout à l'égout" est relatif (même en banlieue de Bruxelles! la rue du Roseau, cela vient seulement de se faire!).
Posté : lun. juil. 14, 2008 10:01 am
par hellin
Mouais… pour moi ta réflexion continue de porter plus sur une comparaison moyen-âge / XXe que sur une comparaison moyen-âge / XIXe…
Le monde rural du XIXe ressemble davantage à celui du moyen-âge qu’à celui du XXe. Au début du XXe siècle, la moitié de la population française travaillait dans l’agriculture. A la fin du siècle dernier, les actifs agricoles représentaient moins de 5 % de la population active… Rien qu’en terme de population , au XIXe on est donc déjà plus proche du moyen-âge…
Alors oui bien sûr la société rurale a perdu à tous les niveaux (mais largement + au XXe, qu’au XIXe) ce qu’elle avait accumulé pendant des centaines d’années : coutumes, techniques, culture,… la liste serait trop longue…
Et effectivement, la révolution industrielle du XIXe et l’industrialisation des zones urbaines ont été de pair avec le développement d'un exode rural motivé par la dégradation des conditions de vie du monde paysan, mais la perte de son identité, qui prenait racine dans les siècles précédents, n’a pas été sèche, mais progressive, jusqu’il n’y a pas si longtemps encore… Tu dis bien qu’il existait encore de telles poches mi XXe…
Je suis donc convaincu qu’il y avait certainement moins de différence dans la façon de vivre la ruralité au quotidien entre le moyen-âge et le XIXe qu’entre le XIXe et le XXe.
Tous les changements sont nés au XIXe, mais c’est quand même au siècle suivant que ça atteint des sommets. Les chemins de fer en France : 379 kms de voies ferrées en 1841, c’est quand même pas là qu’il avait une révolution dans le fret agricole… On privilégiait depuis longtemps et encore pour un temps les voies navigables. La mécanisation… bon peut-être fin XIXe… Le tracteur… développement entre les 2 guerres mondiales… De grandes exploitations agricoles au XIXe, peut-être aussi, mais pas comme on l’entend au XXe ou de nos jours, enfin je ne pense pas, même s’il existait une bourgeoisie propriétaire de domaines agricoles pouvant servir de base au développement d'une industrie (textile par exemple).
Sinon ok avec toi pour dire que la paysannerie ou la société rurale a connu une prolétarisation et un exode croissants au XIXe, du fait de l’industrialisation, des nouvelles techniques, des capitaux et du foncier détenus par les grands propriétaires… Capitaux qui d’ailleurs n’irriguaient pas les économies locales ou régionales. Les propriétaires fonciers réalisaient d'importants profits et pouvaient maintenir des prix élevés sans se lancer dans une modernisation de l'agriculture ni se risquer dans d'autres activités économiques.
Non seulement les revenus tirés de l'agriculture ont été répartis de façon très inégalitaire mais en plus, ils ne contribuaient pas à asseoir le développement du monde rural.
Tout ça a accéléré la dépendance des paysans à l’égard de ces grands propriétaires. Les ruraux pauvres ont commencé à connaître une situation très précaire… d’où exode rural… d’où moins de monde dans les campagnes, d’où moins de monde pour (savoir) vivre comme avant, ou transmettre la ruralité …
Pour finir et pour me recentrer sur le sujet initial de Thierry de Binch : « la différence entre le monde rural du XIXème siècle et le monde rural du MA est t'elle grande à votre avis , en faisant abstraction de l'obligation scolaire bien sur »… je me rallie simplement et très briévement à d’autres, et je réponds tout de même : « oui », ou « bien sûr »…
(avec un bémol : il me semblait tout de même que les lois de Jules Ferry rendaient l’enseignement primaire public, gratuit et obligatoire… l’enseignement, pas la scolarisation… mais ça fait longtemps que j’ai quitté l’école, c’est loin tout ça…)
![smile [img]images/icones/icon10.gif[/img]](./images/smilies/icon10.gif)
Posté : lun. juil. 14, 2008 3:40 pm
par yrwanel
Là, effectivement, ton analyse est exacte!
(décidément...faut que je me remette dans la tête que ce XXème est une solide bascule et affreusement rapide, et que je suis pas "si" vioque que cela...)
![etonné [img]images/icones/icon9.gif[/img]](./images/smilies/icon9.gif)
La scolarisation obligatoire a été un bien, certes, mais aussi un instrument d'a-culturation des régions par l'obligation de la seule langue française au détriment des langues régionales. Et là: si cela donne une notion d'identité nationale, certes, c'est au détriment, à terme, d'une identité de "terroir" donc... paysanne!
Posté : lun. juil. 14, 2008 5:04 pm
par hellin
Pour compléter, voici un article intéressant sur le sujet :
http://ruralia.revues.org/document4.html
Posté : mar. juil. 15, 2008 9:08 am
par Hermelind
Coprolithe de Bonne Atoufer a dit :
La scolarisation obligatoire a été un bien, certes, mais aussi un instrument d'a-culturation des régions par l'obligation de la seule langue française au détriment des langues régionales. Et là: si cela donne une notion d'identité nationale, certes, c'est au détriment, à terme, d'une identité de "terroir" donc... paysanne!
Identité tout court. Etre traitée de "boche" à l'école parce que j'étais bilingue (éh oui, nom italien, mais famille maternelle alsaco-slovène... Ca fait qu'on parle 2 langues : français et allemand), ça calme, surtout à la maternelle. Et quand c'est l'instit. Il y a tout un processus de dégermanisation en Lorraine qui est assez intéressant, sachant que l'Alsace -plus rurale, et avec une immigration moindre- n'a pas été touchée aussi profondément. Ce qui est marrant, c'est que les copines qui causaient en italien étaient rembarrées gentiment. En allemand, c'était violent (Boche, ou bien pire... J'ai au droit au mot avec un z dedans...). Résultat : plus fichue de parler allemand.
Pour le chemin de fer... A la fin du XIXème, les lignes étaient très importantes, sur toute l'Europe. Et je crois me souvenir que dès la fin XIXème, on a préféré, en Provence, privilégier la monoculture. Le réseau a progressé extrèmement vite, et son impact a été énorme sur l'émigration (ce ne sont pas les oeuvres de Daumier qui diront le contraire), interne ou internationale (eh, oh, fin XIXème, mes ancêtres ritals), le tourisme (vi, vi... On peut visiter plein de sites sympas pour pas trop cher... Du coup, plein de gens vont voir les cathédrales !) et l'économie.
Il y a eu, très tôt, des manifestations contre l'arrivée du chemin de fer, parce que s'il amenait de bonnes choses, il amenait aussi tout ce qui était mauvais de la ville... Dont une uniformisation culturelle. Maintenant, avec la télé, c'est encore plus rapide

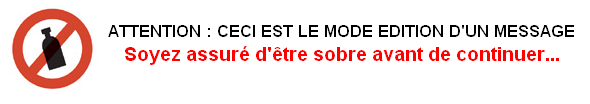
MERCI DE RESPECTER LE SUJET DU TOPIC
Posté : mar. juil. 15, 2008 1:06 pm
par le furet
J'aime pas ces comparaisons parce que les deux ensembles ne sont pas comparables alors que l'attente générale derrière la question est: C'est quand que c'était mieux ?
Bon, un paysan britannique du XIVéme paye l'ensemble de ses impôts en 60jours de travail contre 100 jours pour le farmer de 1900. Oui mais le niveau de service collectif n'est pas le même et dans le deuxième cas, la marche du progrés est une idéologie forte dont le XIVéme n'est pas aussi ostentatoirement pourvu.
Un paysan de Beauce en l'an 1000 produit pour 20 personnes contre 40 pour un paysan de 1860 (et entre 80 et 120 aujourd'hui). Oui mais celui de 1860 bénéficie des espèces américaines (maïs, tournesols, tabacs, tomates, pomme de terre, dindons ...), de l'héritage de la révolution verte du XVIIIéme siècle et de l'appui d'une science nouvelle, l'agronomie. Alors qu'un agriculteur anglais de la seconde moitié du XIVéme par exemple subit une période de trente ans où les céréales pourrissent souvent sur pied et le peu sauvegardé est gâté par l'ergot de seigle. D'ailleurs, L'INRA tient des échantillons de farine pourrie à destination de tous ceux qui pensent qu'avant c'était mieux.
Un propriétaire terrien de 1860 qui veut changer du matos ou investir peut déjà compter sur l'appui d'un systéme banquaire qui lui ouvre d'autres perspectives. Nul doute que le laboureur du MA s'il avait pu en bénéficier pour son compte en aurait tiré de bons bénéfices lui aussi. La révolution industrielle offre aussi un outillage plus performant et durable à l'agriculteur même si souvent cet apport n'est que partiel et que jusque dans les années 50, l'autoconstruction reste répandue, on n'achète alors que les piéces complexes ou mécaniques.
Bref, c'est différent oui, encore mieux, disons que c'est incomparable. Enfin, dans ma famille on a gardé pas mal de photos rurales d'avant le remplacement des chevaux par des Vierzon monocylindre en 1965. Laissez moi vous dire que c'était loin d'être plus sain que de nos jours la vie d'agriculteur...
A+
A+