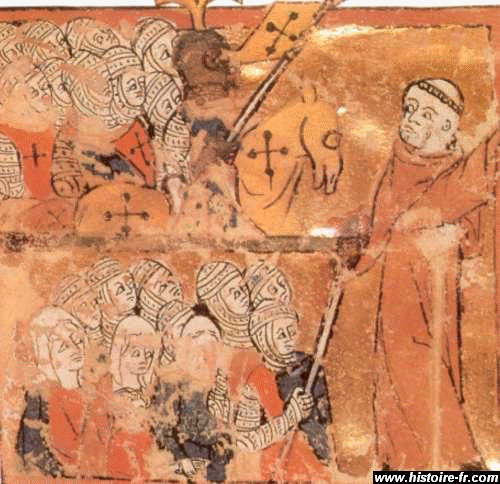Haubert renforcé de cuir (mailles doubles ?)
Posté : ven. déc. 31, 2010 5:21 pm
Je reprends ici un point maintes fois soulevé, et récemment remis sur le tapis par le post du survivant : les « mailles doubles », ou les mailles doublées de liens de cuir.
Le débat porte sur deux points : ce qu’on appelle à l’époque les « hauberts doubliers » ou « mailles doubles », et l’interprétation des différentes représentations de la maille sur les enluminures.
Dans le post du survivant, je relance une hypothèse que j’avais formulée il y a quelques années suite à l’étude d’un haubert XIIIe de collectionneur privé (M. Pascal RENOUX) où quelques lacets de cuir fin étaient encore noués autour de certaines mailles sur le haubert, de mémoire, autour du torse, mais il en restait assez peu, forcément, le cuir résiste moins bien au temps que le métal ! Depuis que j’ai vu ce haubert il y a une douzaine d’année, je n’ai cessé de supposer que les enluminures représentant le type de mailles alternées avec des « bandes » (cf. personnage de gauche et le haubert de celui de droite sur l’enluminure plus bas) pourrait représenter ce type de hauberts renforcés de lacets de cuir.
Alors je m'y suis mis, et j'ai fait les deux essais des deux méthodes histo que j'ai pu voir : en haut, la méthode la plus rapide, celle visible sur le haubergeon XVe du musée de Castelnaud. Il s’agit juste de lacets de cuir fin passés dans les mailles, sans nœuds, sans rien. C'est la plus rapide (mais c'est pas fait en 5 mn, hein !!) la plus ressemblante visuellement avec ce qu’on voit sur les enluminures, mais en revanche, paradoxalement, c'est la moins souple : on sent que le haubert s'en trouve considérablement rigidifié !
La seconde méthode (en bas sur la photo) est celle du haubert XIIIe privé qui appartenait à M. Renoux (il l'a revendu il y a deux ans à un autre collectionneur) : les liens de peau sont "noués" (en fait ça forme une boucle dans la maille, et en resserrant le lien, ça forme une sorte de noeud), ça prend plus de temps (mais avec l'expérience on trouve des astuces pour aller plus vite...je vous laisse expérimenter !) c'est moins proche de l'enlu visuellement, en revanche aussi étrange que ça puisse sembler, le haubert conserve presque toute sa souplesse. Il y a une perte de souplesse, c'est indéniable, mais pas énormément !
En fin de compte c'est logique : les liens étant noués autour des mailles, ça fait une rupture dans le cuir et ça contribue à l'assouplir entre les mailles.
Voilà le rendu sur une enluminure et en photo ce que ça rend en réel sur la maille :


Au passage, le taux de probabilité de se faire transpercer avec ça est encore réduit, déjà que le test autrichien sur un haubert XVe a montré que ça stoppe des flèches de guerre de long bow (120 livres), ce qui n'est déjà pas rien, là on peut se demander ce qu'il en serait face à une arbalète de guerre.
En revanche, plusieurs questions se soulèvent à présent :
- ce système, pour avéré archéologiquement qu'il soit, était-il répandu ? Impossible de prime abord d'y répondre, car il n'y a à ma connaissance qu'un seul exemplaire archéologique de lacets noués dans les mailles (et en plus c'est maintenant en collection privée, ce qui rend d'autant plus difficile l'étude de la pièce) ; le système du haut est déjà plus répandu, certains éléments de mailles (essentiellement XIVe et XVe ayant conservé ce types de lacets surtout au niveau du col)
- quel en est le coût ? Je veux dire, le chevalier fait-il faire ça au château par ses sous-fifres pour économiser la main d'œuvre ou bien le haubert est-il vendu comme ça, donc bien plus cher ?
- est-ce par hasard ce type de mailles qui pourrait être désignée par l'appellation "mailles doubles" ??
- quel est le surpoids sur un haubert complet ?
- est-ce un système destiné à recouvrir l'ensemble du haubert ou seulement certaines zones stratégiques (torse, cou, tête) ? J'aurais tendance à penser que ça ne couvre que les zones stratégiques, mais si on part dans l'hypothèse que les enluminures représentent ce type de mailles doublées de cuir, sur l'icono, ça recouvre tout le haubert...
Bien des points soulevés, bien des interrogations, mais en même temps un petit pas dans les hypothèses pour mieux cerner les hauberts de nos ancêtres.
Allez hop, faîtes comme Moïse, jetez-vous à l’eau et dites-moi ce que vous en pensez ?
Le débat porte sur deux points : ce qu’on appelle à l’époque les « hauberts doubliers » ou « mailles doubles », et l’interprétation des différentes représentations de la maille sur les enluminures.
Dans le post du survivant, je relance une hypothèse que j’avais formulée il y a quelques années suite à l’étude d’un haubert XIIIe de collectionneur privé (M. Pascal RENOUX) où quelques lacets de cuir fin étaient encore noués autour de certaines mailles sur le haubert, de mémoire, autour du torse, mais il en restait assez peu, forcément, le cuir résiste moins bien au temps que le métal ! Depuis que j’ai vu ce haubert il y a une douzaine d’année, je n’ai cessé de supposer que les enluminures représentant le type de mailles alternées avec des « bandes » (cf. personnage de gauche et le haubert de celui de droite sur l’enluminure plus bas) pourrait représenter ce type de hauberts renforcés de lacets de cuir.
Alors je m'y suis mis, et j'ai fait les deux essais des deux méthodes histo que j'ai pu voir : en haut, la méthode la plus rapide, celle visible sur le haubergeon XVe du musée de Castelnaud. Il s’agit juste de lacets de cuir fin passés dans les mailles, sans nœuds, sans rien. C'est la plus rapide (mais c'est pas fait en 5 mn, hein !!) la plus ressemblante visuellement avec ce qu’on voit sur les enluminures, mais en revanche, paradoxalement, c'est la moins souple : on sent que le haubert s'en trouve considérablement rigidifié !
La seconde méthode (en bas sur la photo) est celle du haubert XIIIe privé qui appartenait à M. Renoux (il l'a revendu il y a deux ans à un autre collectionneur) : les liens de peau sont "noués" (en fait ça forme une boucle dans la maille, et en resserrant le lien, ça forme une sorte de noeud), ça prend plus de temps (mais avec l'expérience on trouve des astuces pour aller plus vite...je vous laisse expérimenter !) c'est moins proche de l'enlu visuellement, en revanche aussi étrange que ça puisse sembler, le haubert conserve presque toute sa souplesse. Il y a une perte de souplesse, c'est indéniable, mais pas énormément !
En fin de compte c'est logique : les liens étant noués autour des mailles, ça fait une rupture dans le cuir et ça contribue à l'assouplir entre les mailles.
Voilà le rendu sur une enluminure et en photo ce que ça rend en réel sur la maille :


Au passage, le taux de probabilité de se faire transpercer avec ça est encore réduit, déjà que le test autrichien sur un haubert XVe a montré que ça stoppe des flèches de guerre de long bow (120 livres), ce qui n'est déjà pas rien, là on peut se demander ce qu'il en serait face à une arbalète de guerre.
En revanche, plusieurs questions se soulèvent à présent :
- ce système, pour avéré archéologiquement qu'il soit, était-il répandu ? Impossible de prime abord d'y répondre, car il n'y a à ma connaissance qu'un seul exemplaire archéologique de lacets noués dans les mailles (et en plus c'est maintenant en collection privée, ce qui rend d'autant plus difficile l'étude de la pièce) ; le système du haut est déjà plus répandu, certains éléments de mailles (essentiellement XIVe et XVe ayant conservé ce types de lacets surtout au niveau du col)
- quel en est le coût ? Je veux dire, le chevalier fait-il faire ça au château par ses sous-fifres pour économiser la main d'œuvre ou bien le haubert est-il vendu comme ça, donc bien plus cher ?
- est-ce par hasard ce type de mailles qui pourrait être désignée par l'appellation "mailles doubles" ??
- quel est le surpoids sur un haubert complet ?
- est-ce un système destiné à recouvrir l'ensemble du haubert ou seulement certaines zones stratégiques (torse, cou, tête) ? J'aurais tendance à penser que ça ne couvre que les zones stratégiques, mais si on part dans l'hypothèse que les enluminures représentent ce type de mailles doublées de cuir, sur l'icono, ça recouvre tout le haubert...
Bien des points soulevés, bien des interrogations, mais en même temps un petit pas dans les hypothèses pour mieux cerner les hauberts de nos ancêtres.
Allez hop, faîtes comme Moïse, jetez-vous à l’eau et dites-moi ce que vous en pensez ?