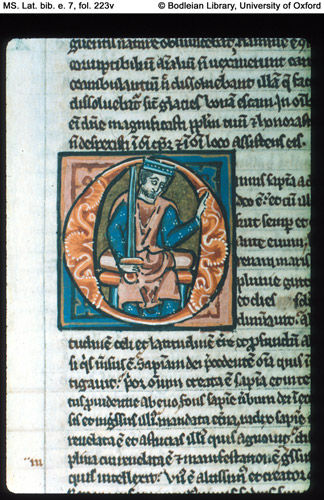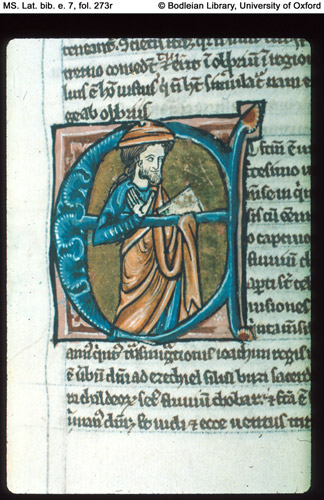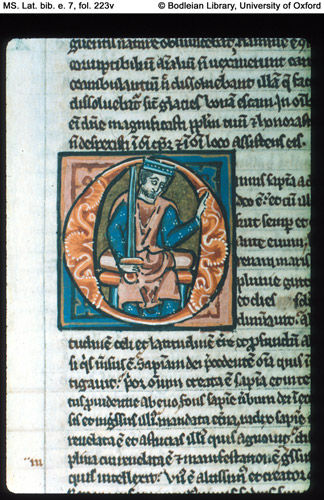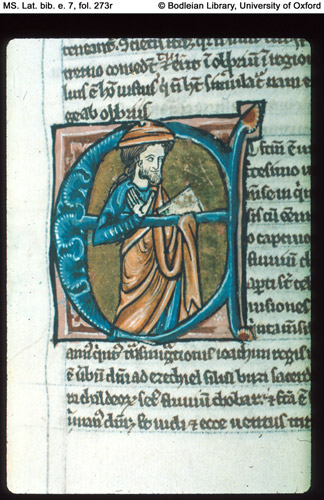mer. janv. 14, 2009 10:36 am
Mes lapinous,vu la taille moyenne des enluminures appelées aussi "miniatures", faut pas rêver que, en prime, on vus file les modèles des broderies...
(ni le détail de la texture du tissu, etc.)
Si on plonge dans "Les Bordeurs" de Staniland... lequel est, effectivement anglais, donc a plus "potassé" le savoir faire et les comptes anglais...
La guilde des brodeurs est BIEN implantée, au minimum à Londres...(mais existe aussi dans le livre des métiers de Boileau)
en tout cas ces guildes sont bien structurées vers la fin XIIIème...assez "tardives" par rapport à d'autres, ce qui ne veut pas dire que broderies y avait pas.
(sinon, suivant cette même logique, y avait pas non plus de guilde des fileuses...et du fil y a eu!)
Les brodeuses et brodeurs travaillent en association avec d'autres... orfèvres, par ex.
Pour la période concernée (p. 9 à 12) soit une grosse partie de mi-XIIIème, Staniland met en exemple (anglais) les comptes de dépenses effectués pour le travail d'une certaine Mabel de Bury St Edmund qui ramassait la "toute belle clientèle".
NB: on a la chance de posséder encore CES comptes.. ce qui n'exclut pas qu'il y en a d'autres (non mentionnées) ou ceux qui ont disparus ou pas encore étudiés....)
Travaux pour le clergé, certes, mais aussi tapisseries murales, étendards...
MAIS, pour le "civil": col, manchettes, bordures, parements (pour Alice de Lusignan)...
Mention d'utilisation de franges (=> passementerie, attestée chez Boileau), or, soie, perles...
Certains artisan(e)s étaient attachés au service d'une maison (on retrouve la trace dans leur émoluments)
L'ennui est que les moins "jet set" laissent moins de "traces", et/ou que les historiens se penchent moins sur "le tout venant".
Pour savoir le "avec quoi qu'on brodait" et la diffusion des matières de façon plus générale: faut aller fouiller dans les comptes d'import-export des marchands....